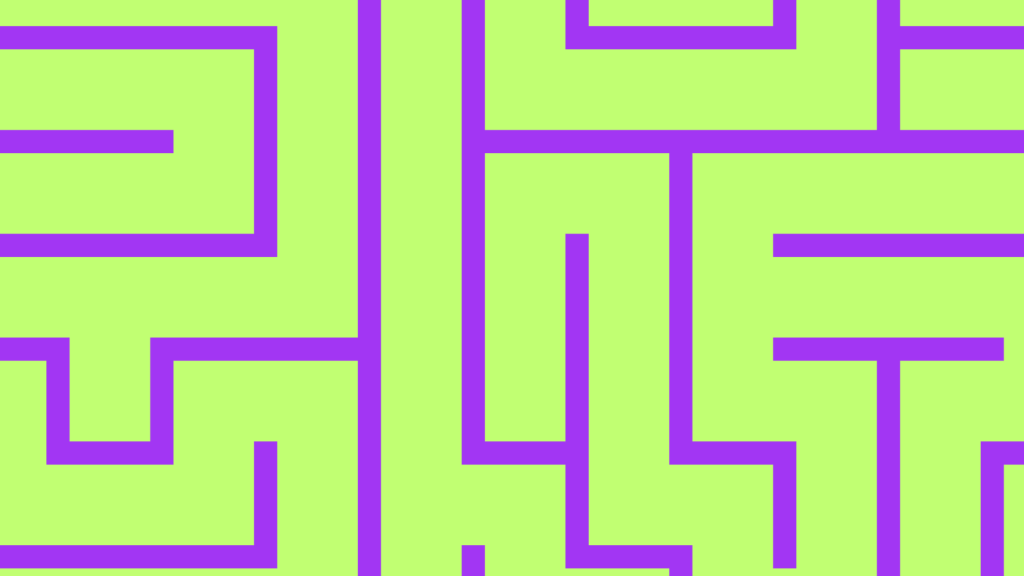
Camille Marcoux, conseillère dans la fonction publique
et Etienne Simard, bibliotechnicien dans la fonction publique
En réaction aux débrayages des dernières années, particulièrement dans les écoles, les garderies et le transport collectif, le gouvernement met de l’avant un nouveau projet de loi visant à limiter le droit de grève. En plus de punir par des coupes budgétaires les quelques victoires salariales obtenues lors des dernières négociations, il veut ainsi éviter qu’une grève générale illimitée comme celle de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) n’éclate à nouveau dans un futur proche.
Le projet de loi numéro 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, introduit la notion de « services assurant le bien-être de la population », un nouveau recul qui élargit la notion de « services essentiels » qui limite déjà significativement la possibilité de recourir au débrayage dans le secteur de la santé. Cette restriction s’ajoute à tout l’arsenal juridique qui rend déjà l’exercice du droit de grève extrêmement difficile, comme la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux ou encore tout simplement le principe de paix industrielle qui interdit strictement l’organisation d’un débrayage pour la durée d’une convention collective.
On connaît déjà le résultat d’une telle mesure. Quand le droit de grève est retiré en tout ou en partie, la résistance prend d’autres formes : insubordination, sit-in, absentéisme, démissions massives. C’est, du moins, l’intuition à l’origine de La grande démission.
Depuis plusieurs années, les démissions de nos collègues et ami·e·s ainsi que celles qui, à l’occasion, font les manchettes, ne constituent pas un phénomène inexpliqué ni surprenant. Au contraire, il s’agit d’une somme de décisions individuelles en réaction à de mauvaises conditions de travail et à une perte de sens de l’activité salariée. Pour le dire simplement, les démissions massives, qui ont mené momentanément à une pénurie de main-d’œuvre, constituent une forme de résistance. Cela dit, autant elles contraignent les employeurs et l’État à concéder des hausses de salaire, autant elles les motivent à exercer une pression à la hausse sur la productivité et le temps de travail. Qui plus est, l’État et le capital réorganisent le travail de manière à ce que d’autres plus précaires reprennent le travail abandonné et de manière à favoriser le recours à l’automatisation pour intensifier le travail. C’est pourquoi ces démissions doivent être organisées politiquement, de manière à orienter la réponse de l’État employeur, avec des ultimatums et des revendications claires.
La suite des choses
Le collectif de La grande démission s’organise de façon autonome, c’est-à-dire sans budget ni affiliation syndicale ou politique. Il réunit des militantes et militants du secteur public désirant allier nos efforts pour organiser nos milieux de travail respectifs sans égards à nos corps d’emploi. Durant les récentes négociations, nos interventions visaient l’ensemble du personnel en négociation en considérant que les avancées ou les concessions d’un milieu de travail influençaient voire confrontaient les décisions des autres. Pour ce faire, des assemblées ont été organisées dans nos milieux et dans l’espace public, des piquets de grève ont été visités, et un bilan de nos expériences a été le sujet d’un second numéro du journal.
Nous voilà maintenant à l’après-négociation ou, devrait-on dire, à l’entre-deux. Le cycle syndical est ainsi défini, en deux périodes : a) les moments où l’on devrait être mobilisé·e, une fois tous les trois à cinq ans, et b) le reste du temps. Durant cette seconde période, le rythme du travail s’accentue, les pressions à la productivité continuent, les postes vacants ne sont pas comblés, les arrêts maladie se multiplient et aboutissent souvent à des démissions. Évidemment, les syndicats ne disparaissent pas pendant ce temps-là, mais leur rôle est fortement circonscrit, ancré dans des rouages bureaucratiques assourdissants. Le syndicalisme canadien d’aujourd’hui, fruit d’une récupération politique des demandes de reconnaissance institutionnelle et juridique des associations de travailleurs, repose sur le rôle de médiation de ses instances. En simple, pour éviter la judiciarisation de ses activités, l’organisation syndicale assure une modération de sa base de manière à ce que sa mobilisation n’affecte pas le cours normal du travail et le droit de gérance de l’employeur. Ce compromis a campé, par la même occasion, le lieu de l’intervention syndicale : les milieux de travail salariés. On s’en remet alors au législateur pour définir la notion de travail se dissociant des luttes pour l’obtention d’un salaire, ou pour la reconnaissance du travail. Pour les autres, par exemple les luttes étudiantes, des stagiaires ou des travailleuses du sexe, certains syndicats adopteront même des positions contestant la légitimité de leurs revendications. La concentration de l’action syndicale sur la négociation de conventions collectives et sur le respect de celles-ci limite son pouvoir de changement et contribue à l’aliénation au travail. Comment le travail est-il réparti au sein de nos milieux, de nos familles ou dans le monde ? Quelles répercussions notre travail a-t-il sur la vie ? Le syndicat ne s’en mêlera pas.
Il va sans dire que cette séparation entre deux moments distincts a aussi pour conséquence de circonscrire les contextes permettant de faire la grève sans risquer une judiciarisation des conflits. En effet, le Code du travail prévoit que la grève ne peut se faire que lorsque la convention collective arrive à échéance et que la négociation achoppe. La « grève politique », c’est-à-dire qui réclame une autre finalité que le changement de conditions de travail, est donc empêchée en deux temps : ses délais de prescriptions et les sujets au cœur de la négociation collective en milieu de travail.
Les luttes antiracistes, écologistes ou féministes sont ainsi reléguées à des comités de travail à peu près sans pouvoirs ou à des combats que l’on doit mener à l’extérieur du travail. La CSN adopte en 1968 la proposition de son président de réfléchir aux luttes sociales comme un « deuxième front ». On pourrait penser que cet appel à la mobilisation permet d’avoir un appareil syndical qui ne fait pas fi de ces enjeux qui modulent nos conditions de vie. Toutefois, son effet est plutôt inverse. Il n’est pas envisagé de se saisir du droit de grève en soutien à ces revendications, et l’on nie la contribution du milieu syndical à ces disparités. On peut penser à la négociation par unité d’accréditation qui renforce les disparités entre les corps d’emploi sans considérer les dynamiques de classe et de race traversant l’occupation de ces différents corps, ou encore aux instances syndicales elles-mêmes marquées par la blancheur et la masculinité des exécutifs syndicaux. De plus, tout le monde qui a déjà organisé une grève sait qu’elle est construite d’un tas de petites actions d’affirmation et d’insubordination qui visent à s’humaniser comme travailleuse et travailleur et à humaniser notre environnement de travail.
D’ailleurs, même pour le premier front, le rythme cyclique de la négociation est désavantageux. Les conventions collectives édictent les obligations attendues de part et d’autre selon une série de considérations du moment présent et passé. Elles sont ensuite figées, et il est présumé que les parties le soient aussi pendant sa durée. Dans la réalité, l’environnement dans lequel se réalise le travail continue de changer, et les employeurs ne manquent pas d’innovation pour continuer à tirer davantage de travail. Lorsque l’employeur détient aussi un pouvoir législatif, le déploiement de cette réorganisation est parfois plus évident, et nécessairement plus efficace. C’est sous la loupe de cette réorganisation que l’on doit évaluer les gains de la dernière négociation collective. Par exemple, la hausse des salaires permet-elle un dépassement de l’inflation, mais aussi de la hausse des loyers facilitée par le retrait de mesures de protection pour les locataires ? Ou encore, l’amélioration de certaines conditions de travail ont-elles permis une amélioration de notre travail en considérant les coupures de postes, le gel d’embauche, et le refus de remplacer les personnes qui quittent ? En abdiquant nos moyens d’action pendant cet entre-deux, on se retrouve à perdre les minces gains faits pendant la négociation.
L’organisation entre collègues sur leur milieu de travail semble être la seule issue pour dépasser les stratégies de compartimentation des luttes et de division des travailleurs et travailleuses. Les expériences diversifiées de chacun·e sont des forces, et non des obstacles à l’unité. Au quotidien, toutes les dynamiques de compétition entre collègues, entre les corps de métiers, entre les accréditations syndicales doivent être combattues. C’est un minimum avant d’espérer combattre les divisions raciales, les divisions entre les travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés. Dans cet esprit, la compréhension stratégique des démissions doit être complexifiée et la proposition d’organiser les démissionnaires ne peut se limiter à ces dernières. La démission représente certes la prise d’un risque et la perte d’un nombre d’avantages et de droits, il s’agit toutefois d’une porte de sortie inaccessible à plusieurs. Les personnes sans diplomation ni formation reconnue, celles qui partagent leur revenu avec leurs proches au Canada ou ailleurs dans le monde, celles qui vivent de la discrimination en embauche ou celles dont le statut légal dépend d’un permis fermé n’envisageront pas de démissionner de leur travail. Plus encore, le travail de reproduction ne diminue pas et il ne se délocalise pas. Il continuera d’être réalisé par les personnes qui n’ont souvent pas beaucoup d’autres options. Le secteur de la reproduction est ainsi tranquillement déserté par les femmes blanches et leurs tâches déléguées aux populations migrantes. Cette dynamique justifie d’autant plus la nécessité d’organiser les démissionnaires afin que leurs critiques ne soient pas récupérées pour blâmer les populations migrantes chargées d’une bonne partie du travail de soin.
Le rapport de force est nécessairement politique
Plusieurs critiquent les syndicats de se limiter à des revendications économiques comme les salaires. Ces critiques considèrent comme « politiques » seulement les revendications qui concernent des réformes et des déclarations de principes. Nous pensons au contraire que l’action des travailleuses et travailleurs est toujours politique. Le développement économique, la productivité, la croissance, bref le cours normal des choses est économique. Tout ce qu’on impose à ce développement est politique, tout ce qui l’oriente vers d’autres horizons.
La question du temps de travail semble être un des enjeux à mettre de l’avant pour orienter la lutte. C’est simple, les collèges veulent travailler moins et ne manquer de rien. Gagner du temps hors travail pour passer du temps de qualité avec leurs proches, pour apprendre à jouer d’un instrument, faire du plein air ou simplement se reposer. On peut le faire, par exemple, en réclamant un salaire égal pour toutes les catégories d’emploi et une réduction du temps de travail, basé sur les besoins et non sur le supposé mérite. Le passage à un horaire de quatre jours par semaine sans perte de salaire a d’ailleurs été la proposition la plus populaire lors d’une assemblée générale d’une section du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) alors que se préparait le cahier de demandes pour les négociations 2023. Le désir de liberté fait assez facilement consensus entre les collègues. Le gain de temps pour chaque individu sert aussi les intérêts d’une collectivité organisée, puisqu’il s’agit d’un obstacle important à la mobilisation. Les revendications qui sont en mesure d’améliorer les conditions des individus comme celles des collectivités peuvent permettre leur radicalisation en leur donnant les moyens de le faire. Il s’avère donc essentiel de s’attaquer à ce qui nous divise pour nous permettre ensemble d’exiger plus. Ces actions s’inscrivent dans le long terme en visant la constitution d’une classe en force politique.
Construire une solidarité avec les usagers
Au moment de réclamer de meilleures conditions de travail ou de dénoncer les différentes coupures ou réorganisations du secteur public, les syndicats consacrent une grande partie de leur campagne de mobilisation à rallier l’opinion publique. On demande à la population de se solidariser avec les employé·e·s de l’État pour défendre la préservation des services publics. Cette solidarité a son importance et contribue à mener la lutte plus loin, comme en 2023 lorsque plus de 70 % de la population appuyait la grève générale illimitée des profs qui a duré cinq semaines. Malheureusement, il s’agit toujours d’une demande à sens unique, et d’une alliance circonstancielle et temporaire.
L’équation RÉINVESTISSEMENT = PLUS D’EMBAUCHES ET MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL = DE MEILLEURS SERVICES PUBLICS n’est que partiellement vraie. Évidemment, les services souffrent du manque de personnel et de la surcharge de travail, comme des ratios patients/infirmière trop élevés ou des classes trop nombreuses avec des élèves à besoins particuliers. Mais le problème n’est pas seulement d’ordre quantitatif.
Les services publics sont le résultat de la socialisation du travail domestique. C’est le refus des femmes à élever des familles nombreuses et à prendre en charge gratuitement le soin, l’éducation et le soutien à temps plein qui a contraint l’État à convertir ces tâches en emplois salariés et en prestations sociales. Il l’a fait, cependant, de manière à mettre au travail les usagères et usagers. N’importe quelle proche aidante vous dira combien d’heures par semaine sont nécessaires pour assurer qu’un·e patient reçoive des soins adéquats à domicile ou au CHSLD. Même chose pour un parent d’élèves qui accompagne ses enfants vers la réussite scolaire, encore plus s’ils ont des besoins particuliers. Même quand on est soi-même l’usager, que ce soit pour accéder à des services de santé, à l’aide sociale ou aux études, des heures de démarchage sont inévitables avant, pendant et souvent après la prestation de services. Personne ne reçoit passivement un service.
Les services publics sont aussi indissociables du rôle de coercition de l’État. Chacune de ses institutions conserve une logique de surveillance et de punition. On pense facilement aux intervenants sociaux, aux agents d’aide sociale ou à l’école qui trient les individus selon des critères sociaux et raciaux. On retrouve des dynamiques semblables dans les soins de santé, parfois avec des conséquences dramatiques, l’histoire de Joyce Echaquan est un exemple parmi tant d’autres.
Afin de compter sur un appui de la population, les travailleuses du secteur public doivent retourner l’ascenseur et établir une alliance continue. Il faut revoir notre perspective sur le travail qu’on fait : considérer que nous ne sommes pas au service des gestionnaires et ministres, mais plutôt qu’on travaille avec les usagers. Notre engagement en ce sens peut prendre plusieurs formes : refus collectif du « poliçage » des usagers dans les tâches courantes ; prises de position ouvertes sur nos milieux de travail et dans nos syndicats contre le racisme, l’islamophobie et l’acharnement sur les personnes migrantes ; renoncement au devoir de réserve ou de loyauté pour partager des réflexions et informations cruciales, usage des « petites grèves illégales » comme les sit-in pour manifester autant le refus des mauvaises conditions de travail que des mauvaises conditions de services. L’amélioration de nos conditions sera aussi rendue possible par le refus des dimensions de notre travail qui font la vie dure aux usagers. Il n’est pas rare de voir l’opposition avec les usagers aboutir à des actes de violence envers le personnel ou encore du personnel envers les usagers. Ces gestes, qu’ils soient petits ou grands, contribuent certainement à la souffrance au travail et à notre aliénation. Agissons avec conséquence et réclamons de meilleures conditions pour toutes et tous, par exemple en demandant un salaire pour les usagers, avec qui l’on travaille étroitement dans la prestation et l’accès aux services. Ce changement de perspective, qui repose sur un rapport horizontal et collégial entre travailleurs et usagers, est nécessaire pour établir une solidarité réciproque et durable. Les étudiantes et étudiants sont des travailleurs en formation. Les patientes et patients, des travailleurs en rémission. Les prestataires de l’aide sociale, des travailleurs au chômage. Face aux décideurs, nous sommes toutes et tous des collègues.