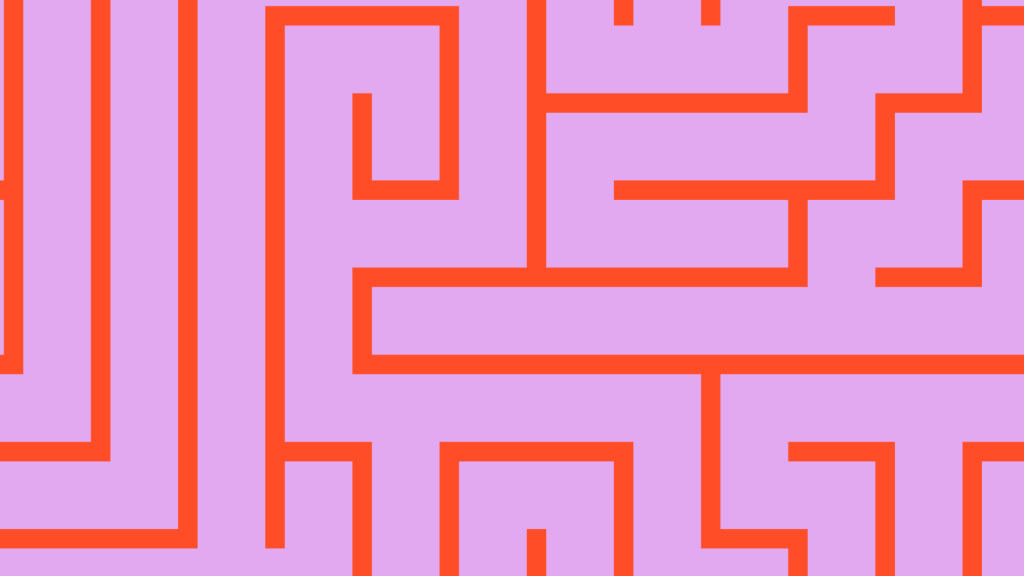
Nancy Yank, technicienne en éducation spécialisée dans un centre de services scolaire
Face à la pénurie de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu privé a augmenté le recours aux travailleuses et travailleurs temporaires racisé·es1. Plusieurs emplois faiblement rémunérés dans les domaines essentiels des soins, de l’agriculture et de la restauration sont boudés par la main-d’œuvre locale. Puisque ces industries ne peuvent être délocalisées vers les pays du Sud, divers programmes gouvernementaux favorisent la migration d’une certaine main-d’œuvre vers le Nord. L’Observatoire pour la justice migrante dénonce que ces politiques sélectives, teintées d’une logique coloniale, perpétuent des discriminations raciales et créent un terreau fertile à l’exploitation2. Le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)3 permet à notre économie capitaliste de fonctionner en répondant à des besoins permanents, par l’utilisation d’une main-d’œuvre temporaire, mais à quel coût humain ?
Au-delà des statistiques qui convergent et confirment cette tangente évidente, j’ai voulu présenter un portrait plus humain de cette question en faisant porter la voix de deux travailleuses immigrantes africaines arrivées au Québec via le PTET. Elles ont été recrutées pour un contrat de travail fermé, d’une durée de trois ans, dans des résidences privées pour personnes âgées en perte d’autonomie. Leur témoignage nous aide à comprendre pourquoi démissionner n’est pas une solution possible pour tout le monde.
Portrait
Emeline a 40 ans et est préposée aux bénéficiaires. Elle habite près de Montréal depuis bientôt quatre ans et travaille depuis juillet 2024 dans un CHSLD à la suite de l’obtention de sa résidence permanente.
Fadila a 38 ans et est cuisinière. Elle est au Québec, en Estrie, depuis deux ans et demi et travaille sous le PTET dans une résidence privée pour personnes âgées.
Emeline et Fadila, en plus d’être originaires de pays francophones d’Afrique et d’être passées par le PTET, ont en commun d’être mères. Comme plusieurs autres femmes immigrantes avec le même statut d’emploi, elles ont fait ce sacrifice, rempli d’amour, que l’on pourrait difficilement imaginer être capable de faire: se séparer de leurs enfants durant plusieurs années. Cette décision a été motivée par l’espoir de voir les conditions de vie à long terme de leurs enfants s’améliorer ; l’immigration au Canada symbolise une meilleure éducation, des services de santé universels, une perspective d’emploi avec couverture sociale, etc.
C’est du moins ce qu’on leur a présenté pour les convaincre d’adhérer au programme de contrat de travail fermé. Cette démarche est la première étape, pour ensuite faire la demande de résidence permanente et faire venir la famille au Canada. En ce qui concerne leur recrutement, il s’est fait directement par l’employeur pour l’une et par une agence de recrutement pour l’autre. Emeline explique que ce n’était pas du tout dans ses projets personnels ni dans sa perspective de carrière de venir ici. « On m’a lancé l’hameçon, on m’a pêchée. Ça sera bien pour l’éducation des enfants […], on m’a convaincue. Mon rêve est que mes enfants voyagent. » Pour eux, elle a donc décidé de sacrifier le bon emploi syndiqué qu’elle occupait au pays, à l’hôpital de la zone portuaire. Peu de gens ont accès à une assurance maladie et sociale d’où elle vient. L’idée de pouvoir en faire bénéficier sa famille s’avérait un attrait de taille dans son choix migratoire.
De son côté, Fadila a principalement pris cette décision pour que son fils vivant avec un handicap puisse recevoir des services adaptés. Parmi ces services, elle pense en particulier à son éducation: actuellement, pour que son fils soit scolarisé, elle doit payer un assistant qui prend des notes sur la matière en classe afin de lui permettre de poursuivre le programme régulier.
Conditions de travail et désillusion
Les deux résidences privées d’une centaine de places, qui offrent 3 repas par jour, accueillent des personnes âgées de divers niveaux d’autonomie. Les résident·es sont toutes et tous plus autonomes qu’en CHSLD. Que ce soit en cuisine ou comme préposée, Fadila et Emeline travaillent minimum 35 heures par semaine. Leur horaire de travail varie entre 3 h et 15 h par jour. Les longs quarts sont rarement payés en heures supplémentaires, comme nous le dit Emeline: « Le temps supplémentaire se calcule à la somme de tes deux semaines, si tu as plus de 80 h, là c’est considéré comme du temps supplémentaire (à taux et demi) ». Une première différence marquée avec le CHSLD où les heures supplémentaires sont calculées dès que tu dépasses ton quart de travail (habituellement de 7 h ou 8 h) dans la même journée.
Quelques mois après son arrivée, Fadila a obtenu une promotion. Malgré ses nouvelles responsabilités, elle est restée sans augmentation salariale. Elle tente en vain de trouver une logique dans les décisions de l’employeur: « Lorsque le salaire minimum est monté à 15,75 $/h, nous on est restées à 15,15 $/h […] Je pense qu’à la base ils se disent qu’on n’est pas souvent au courant de ces choses-là. » Fadila pose aussi l’hypothèse que l’employeur se permet un salaire différencié pour les employées sur le PTET puisqu’« ils se disent avoir investi », en ayant payé leur billet d’avion. À l’automne 2024, alors qu’elle sentait avoir fait ses preuves, elle a demandé une augmentation de salaire, pour finalement obtenir un taux à peine plus élevé que le salaire minimum.
Lorsque je les questionne sur l’information qui circule dans leur pays d’origine concernant le projet de venir au Canada, Fadila partage avec moi son impression que la majorité tombe dans un piège: l’illusion qu’il sera possible d’amasser assez d’argent pour subvenir à leurs besoins, mais aussi à ceux de leur famille toujours au pays4. « Pour dire vrai, le salaire ne peut pas vraiment te permettre de vivre aisément […] le coût de vie est tellement haut. » Le rêve d’obtenir une sécurité financière, que ce soit pour immigrer de façon permanente ou pour retourner chez elles un jour, s’est donc rapidement brisé. Un autre aspect non négligeable est l’attente assez répandue que l’argent gagné doit être envoyé à la communauté restée de l’autre côté de l’océan, parfois même pour une question de survie. Mostafa Henaway expose l’important flux économique Nord-Sud créé par ces transferts de fonds, au profit de la business monétaire (principalement Western Union) exponentielle. En 2021, il y aurait eu environ 2 milliards de transactions en 1 an5.
Il arrive parfois des complications administratives qui ajoutent des coûts imprévus dans le projet d’immigration. C’est ce qui est arrivé à l’une d’elles concernant un libellé sur son permis. « Au départ, on me recrutait en tant que cuisinière, mais lorsqu’on avait fait mon permis de travail ça avait été mis comme préposé·e aux services alimentaires. Mais moi, au pays, on me disait que quand je voyais écrit préposé·e aux services alimentaires… je me disais que c’était peut-être notre façon d’appeler travailler en cuisine. […] Mais rendue ici, je me suis rendu compte que préposé·e aux services alimentaires ne me permettait pas de faire venir mes enfants. Donc là, j’ai dû modifier mon permis de travail pour mettre cuisinière. » Suite à quoi, deux années supplémentaires se sont ajoutées à son contrat fermé.
Pas de couverture, pas d’assurance, pas de syndicat, pas de recours
Lors de nos échanges, Emeline et Fadila me parlent souvent des difficultés de connaître leurs droits et les bénéfices qu’elles peuvent attendre de leur employeur puisqu’elles n’ont pas de convention collective. Si leur contrat fermé permet d’avoir accès à la carte d’assurance maladie, toutes les deux ont entendu dire qu’elles avaient seulement droit à deux journées de maladie payées par année, mais sans aucune trace écrite ! Elles ont donc l’impression que le seul recours pour améliorer leurs conditions de travail repose sur le fait d’avoir un employeur qui semble ouvert à recevoir des demandes. Elles ont fait leurs propres recherches sur le site de la CNESST, lors du décès d’un parent proche, puisqu’aucune journée de congé de deuil ne leur avait été payée. Des démarches semblables ont été nécessaires lorsque Fadila s’est blessée et a été forcée de s’absenter du travail sans compensation. Elle m’explique que, dans sa condition, elle n’a pas osé faire de démarche pour l’accident de travail. « Parfois, on ne s’exprime pas vraiment parce que tu es comme souvent dans la peur ; peut-être qu’on va me retourner, peut-être qu’ils seront pas contents, il y a toujours cette psychose-là, donc parce qu’ils ont ce pouvoir-là de pouvoir annuler le contrat […] C’est le patron qui décide, c’est le patron qui a le dernier mot. »
De son côté, Emeline a posé la question à ses collègues lors de son arrivée: pourquoi il n’y a pas de syndicat ? Il semblerait que cela ait toujours été refusé par les propriétaires dans le passé. Elles ont de toute façon l’impression que les autres collègues ne se mobiliseraient pas, et encore moins pour des problématiques qui ne concernent pas directement leurs conditions de travail. Leurs réalités diverses et la complexité administrative semblent constituer des obstacles de plus pour arriver à se défendre en groupe.
Quand il est impensable de démissionner ; un esclavage moderne
Avec un statut de citoyenneté au Canada, lorsque nos conditions de travail ne nous arrangent pas, nous pouvons chercher un autre emploi. Les démissions de plusieurs travailleuses du secteur public au Québec ont été documentées dans les éditions précédentes du journal de La grande démission. Or, les travailleuses sous le PTET peuvent difficilement recourir à la démission, comme nous l’explique Fadila: « Tu n’es pas libre de partir. […] C’est juste l’esclavage, mais de manière moderne un peu, parce que tu es carrément prise au piège. Tu peux rien faire d’autre, puisque tu arrives ici, tu te rends compte que le montant ne peut pas vraiment te permettre de bien vivre, tu peux pas chercher mieux, tu es comme obligée de rester dans cette situation, donc être dans [un contrat fermé], c’est pas avantageux. »
Selon l’Observatoire pour la justice migrante6, le manque de liberté de ces travailleuses et travailleurs étrangers·ères temporaires les rend vulnérables et à risque de vivre des abus et de l’exploitation. C’est ce que dit Emeline, lorsqu’elle explique qu’en contrat fermé « à la résidence, on est plus contraint [qu’au CHSLD], un peu comme une dictature, on travaille un peu comme dans la dictature, tu ne peux pas trop donner ton opinion ». Elles se font donc une carapace et épuisent leur patience durant le temps prescrit au contrat, afin de ne pas mettre en péril le projet d’immigration pour lequel beaucoup de sacrifices ont déjà été faits. En effet, « c’est pas évident pour nous de penser à démissionner », me dit Fadila. Une telle décision impliquerait de rompre leur contrat de travail, ce qui entraînerait généralement une expulsion du pays ou l’obligation de trouver un autre employeur pour demeurer au Canada. Comme le note Fadila, « c’est encore toute une paperasse. Mais on a tout laissé, tu vas pas retourner [en Afrique] comme ça. Les emplois ne sont pas à portée de main », en somme, « vraiment, démissionner, ça ne te passe pas [par la tête]. Peu importe les conditions, même si ça ne fait pas ton affaire […], tu es pris au piège ».
Changement de statut
Lorsque Emeline a réussi à obtenir sa résidence permanente, à la fin de son contrat de trois ans, les démarches ont permis à son conjoint et à ses deux enfants de venir la rejoindre. Elle a alors postulé dans le réseau public et débuté comme préposée aux bénéficiaires dans le CHSLD le plus près de chez elle. Cela lui a valu une augmentation de salaire d’environ 40 %. Elle apprécie les horaires et les autres avantages sociaux auxquels elle a droit au CISSS, comme le fonds de pension et les 8 jours de maladie. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle continue tout de même de travailler dans la résidence privée. Par contre, elle s’exprime davantage au travail, ne craignant plus les représailles liées à son ancien statut précaire. « Je me suis syndiquée moi-même ! » m’explique-t-elle en riant, car « si je ne parlais pas avant c’était pas parce que je ne voyais pas que ce n’était pas bien ». Maintenant qu’elle ose prendre la parole pour trouver des solutions aux enjeux problématiques qui perdurent, elle sent que ça dérange. L’employeur n’était d’ailleurs pas content qu’elle soit allée travailler ailleurs à la fin du contrat.
Emeline a tout de même vécu une période difficile d’adaptation et d’acceptation lors de ses débuts au CHSLD où elle a été accueillie avec beaucoup de réticences par ses nouvelles collègues, à cause de préjugés racistes. « Ils pensent que le monde qui sort [de cette résidence] sont de mauvais employé·es. J’ai entendu quelqu’un dire qu’on allait ramasser des Africain·es en Afrique dans des conteneurs. J’ai eu envie de démissionner. » À la suite de diverses situations vécues, dont des conflits avec une collègue particulièrement conflictuelle, elle n’a pas eu le choix de rencontrer la superviseure. Les besoins étant plus complexes et le matériel de travail n’étant pas le même, elle souhaitait qu’on lui donne le temps d’apprendre et de s’adapter. Heureusement, ce n’est pas tout son nouveau milieu de travail qui avait cette attitude et, depuis, les choses se sont replacées avec la collègue en question.
Emeline n’a pas encore eu besoin de se référer à son syndicat, mais advenant le cas, elle sait à qui s’adresser. « Je vois, quand on nous envoie les courriels et tout, les personnes qui travaillent c’est pour la bonne cause du travailleur […] ils envoient des débats, tu peux donner ton opinion. » Même si elle n’a pas le pouvoir de changer les choses dans cette grande structure, elle apprécie pouvoir donner son opinion et recevoir l’information au lieu de recevoir un simple « non, sans justice » comme c’était le cas sous le programme PTET.
Pénurie et roulement de personnel
Dans un marché de l’emploi vivant une pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ont tout avantage à embaucher des travailleuses et travailleurs migrant·es à contrat fermé puisqu’elles et ils assurent une certaine stabilité dans leur équipe. Fadila était étonnée à son arrivée de côtoyer autant de collègues qui quittaient après quelques jours de travail seulement. Elle ne comprenait pas pourquoi les Québécois·es se permettaient de démissionner, comme s’il n’existait pas de factures à payer. Face à ce manque constant de personnel, de plus en plus d’Africain·es ont été embauché⋅es dans la résidence où elle travaille (principalement des contacts et des membres de la famille élargie des employé·es).
Emeline ressent davantage la pénurie de main-d’œuvre au CHSLD et encore plus depuis la fin du recours aux agences de placement privées. Sans même que les supérieur·es aient pris le temps d’expliquer aux équipes ce changement, elle a vu la charge de travail augmenter. « On ne t’oblige pas de rester [… mais] il y a une pression pour rester. Quand on te demande, ils sont pognés, il n’y a personne. La façon qu’on te le demande, c’est un peu comme si c’était une obligation. » C’est donc souvent par bonne conscience, pour ne pas laisser tomber les collègues à effectif réduit, que la décision de faire un quart de travail double se prend, malgré la fatigue. Pas étonnant que des collègues quittent le CISSS afin d’obtenir un meilleur revenu et des horaires choisis. Pour combler les trous, l’agence Santé Québec a mis en place des équipes volantes dans plusieurs régions de la province. L’existence de ces équipes crée des tensions dans les milieux de travail puisqu’elles gagnent un meilleur salaire que les préposé·es sur place pour les mêmes tâches à exécuter. Emeline conclut que ces équipes volantes travaillent un peu comme les agences.
Solutions ?
Suivant leur expérience du PTET, Emeline et Fadila proposent plutôt aux gens de passer par la résidence permanente, puisque celle-ci leur permet de venir dès le début avec leur famille et de choisir leur employeur. Il devient impératif de changer la structure qui perpétue une classification raciste des emplois précaires et temporaires. Il est nécessaire de considérer les situations réelles de ces personnes qui arrivent, d’ailleurs, pour faire un travail essentiel, peu prisé par les Québécois·es. Les personnes migrantes ont encore des dépenses à faire dans leur pays d’origine. Pour ne donner qu’un exemple, Fadila m’explique ne pas pouvoir déclarer avoir trois enfants à charge dans ses impôts puisqu’ils n’habitent pas au Canada. Pourtant, une bonne partie de ses revenus sont toujours voués à subvenir à leurs besoins pendant qu’ils habitent chez leur grand-mère. N’est-ce pas ironique que ces travailleuses temporaires n’aient pas accès durant leur contrat aux mêmes droits humains qu’elles revendiquent pour leurs enfants en choisissant la migration ?
Le rapporteur spécial de l’ONU, Tomoya Obokata, à la suite de visites dans plusieurs provinces pour évaluer la lutte contre les formes contemporaines d’esclavages, a mentionné que le « Canada doit […] faire en sorte que tous les travailleurs migrants aient accès à une procédure claire d’obtention de la résidence permanente dès leur arrivée dans le pays. »7 Cette déclaration a fait suite aux constats que le PTET « institutionnalise les asymétries de pouvoir qui favorisent les employeurs et empêchent les travailleurs d’exercer leurs droits. »8 D’autres organisations ont pris position en ce sens, dont la CSN qui demande au gouvernement d’adopter une vision plus inclusive de l’immigration en s’attaquant aux facteurs précarisants, entre autres, par l’abolition du permis de travail fermé9.
Cette volonté de garantir des conditions de travail qui respectent des principes d’équité, de sécurité et de dignité humaine pour toutes et tous doit inclure une réflexion sur les solidarités entre les travailleuses et travailleurs de tous les milieux. Avec intelligence et humanité, Mostafa Henaway expose dans son livre Essentiel Work, Disposable Workers10 la nécessaire solidarité entre syndiqué·es et non-syndiqué·es qui est actuellement peu présente. Dans une perspective d’organisation collective, nous avons un devoir d’agir, puisque les problématiques vécues par ces personnes migrantes sont structurelles. Il faut à tout prix éviter le piège de créer des hiérarchies entre immigrant·es et les travailleuses et travailleurs, mais plutôt élargir notre analyse du local au global face à ce système économique néolibéral et colonial qui crée ces inégalités. Henaway propose de bâtir des organisations de travailleuses et travailleurs qui donnent le leadership à celles-ci11. Ce serait un bon début. Je nous encourage à établir des dialogues et à créer ces initiatives.
Je tiens à remercier Emeline et Fadila d’avoir généreusement partagé leur expérience personnelle et leur vision de leurs conditions de travail avec moi. Leur résilience est forte et inspirante.
- Au Canada, le nombre de travailleur•es étranger•ères temporaires sous le PTET s’est multiplié par 8 entre 2015 et 2023. Hadj-Kaddour, Dumont-Robillard et Ndiaye, Les travailleur•ses temporaires et la construction d’une classe d’immigrant•es indésirables: Survol historique des racines coloniales et esclavagistes des politiques migratoires au Canada, octobre 2024, (p. 28): https://observatoirepourlajusticemigrante.org/wp-content/uploads/2024/10/FINAL-Article-socio-histoire-de-limmigration-des-travailleur%C2%B7e%C2%B7s-au-Canada.pdf ↩︎
- Idem, p. 2-29-30. ↩︎
- « Les travailleurs étrangers peuvent venir au Québec dans le cadre du PTET pour une durée initiale qui varie généralement entre 6 mois et 3 ans, en fonction du contrat de travail, du type de permis de travail, du secteur d’activité, ou des caractéristiques du poste », Démarches Québec, 4 décembre 2024: https://demarches.quebec/
programme-travailleurs-etrangers-temporaires-ptet/#aioseo-quels-types-demplois-et-conditions-de-travail-pour-les-travailleurs-etrangers-temporaires-au-quebec ↩︎ - Suggestion de lecture: Americanah (2016) de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce
roman illustre bien l’illusion d’une possible richesse financière en partant de l’Afrique pour aller travailler en Amérique du Nord. ↩︎ - Mostafa Henaway, Essentiel Work, Disposable Workers, p. 49-50, 20 juillet 2023. ↩︎
- Hadj-Kaddour, Dumont-Robillard et Ndiaye, Les travailleur•ses temporaires et la construction d’une classe d’immigrant•es indésirables: Survol historique des racines coloniales et esclavagistes des politiques migratoires au Canada, octobre 2024, p. 4 et p.30: https://observatoirepourlajusticemigrante.org/2024/09/27/les-travailleurses-temporaires/ ↩︎
- Chenour Oechslin, « Resserrement des programmes d’immigration temporaire : des mesures qui risquent d’amplifier la précarité et l’exclusion des personnes sous statut temporaire », 10 octobre 2024: https://observatoirepourlajusticemigrante.org/2024/10/10/resserrement-des-programmes-dimmigration-temporaire/ ↩︎
- Idem. ↩︎
- CSN, Élections 2025 le vrai bon sens, p. 5: https://www.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/web_fr_broch_elect_fed_2025.pdf ↩︎
- Mostafa Henaway, Idem. ↩︎
- Idem, p. 189. ↩︎