
Entrevue avec Yann Moulier Boutang, économiste et militant
Dans un récent article [1], l’économiste et militant de longue date dans la mouvance autonome s’est prêté à l’analyse de la « grande démission ». En traçant un lien entre différents phénomènes à l’international comme la Great Resignation nord-américaine, le hikikomori japonais (l’auto-réclusion) et le tang ping chinois, il suggère que la cause soit bien plus une perte de sens généralisée du travail que les mauvaises conditions dans lequel il s’exerce. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions.
Vous considérez la « grande démission » et autres phénomènes semblables à l’international comme des formes de refus du travail. À quoi le « refus du travail » réfère-t-il?
Le thème du refus du travail comme clé de lecture de la construction du rapport salarial et de sa particularité historique dans l’accumulation du capital a été illustré sur le plan théorique par le courant opéraïste italien dans les années 1966-1973, principalement par Mario Tronti, qui vient de mourir à 92 ans et dont j’avais traduit en français le principal ouvrage Ouvriers et capital [2]. L’idée centrale exposée dans l’essai publié en 1966 et longuement analysé dans ma thèse De l’esclavage au salariat : économie historique du salariat bridé [3] est que la particularité historique du rapport salarial par rapport au travail subordonné issu du servage ou de l’esclavage moderne n’est pas la production de plus-value ou survaleur, mais de ne produire du capital que pour autant que l’argent (moyens de production et salaire) s’expose au refus du travail, ce qui peut se traduire par les multiples formes de fuite. L’histoire du capitalisme n’est pas, comme souvent le marxisme classique l’a pensé, la mise en place de l’accumulation de moyens de production comme conditions de la mise au travail des prolétaires, mais le contraire, c’est-à-dire la mise en place du travail libre (c’est-à-dire libre de refuser, de fuir le rapport d’assujettissement) comme condition de la transformation de l’argent en capital.
L’idée conductrice est qu’il faut lire l’histoire du capital à partir de l’histoire de la construction du salariat libre. Et pas l’inverse. S’il n’y a pas la possibilité (de fait, puis juridique et consolidée dans le droit du travail spécifiquement distinct du droit commercial) pour le travail dépendant et subordonné, de refuser le travail sous toutes ses formes (par exemple le droit de grève, le droit de rompre le contrat de travail, le droit de fuite), mais aussi de combattre au sein de cette relation de travail (sabotage, grève du zèle), le capital n’a plus aucune dynamique ni ressort de l’accumulation.
Il faut donc être attentif à toutes les formes de refus de la part du travail subordonné ou dépendant d’être une variable muette ou purement fonctionnelle. La grande démission marque un retour de cette phase particulièrement forte de la lutte des classes des années 1962-1980 qui a connu une éclipse entre 1980 et 2000. Une vision traditionnelle de la lutte de classe en faisait une variable subalterne, subordonnée à la puissance technologique des conditions économiques « objectives », une sorte de supplément d’âme pour le fun ou le détail. La vérité et surtout la règle (qui peut souffrir quelques exceptions) est que lorsque le refus du travail est très fort, le capital est contraint de se renforcer, de mettre davantage de moyens de production, de technologie pour contrôler l’insubordination ouvrière, ou les mouvements des prolétaires qui ne sont pas (encore) ouvriers.
Les employeurs et l’État utilisent l’argument de la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs pour exiger une hausse de la productivité et une augmentation du nombre d’heures travaillées. Vous soutenez au contraire que, dans la situation actuelle, le pouvoir de négociation se modifie en faveur des salarié·e·s. Quels effets peut avoir cette évolution du rapport de force?
Historiquement, l’argument de la pénurie de main-d’œuvre n’est pas un faux prétexte : plus il y a refus du travail spécifiquement et historiquement déterminé, sous ses formes les plus diverses, plus trouver de la main-d’œuvre disposée à entrer dans le rapport d’exploitation est difficile. Cela veut dire que les patrons ou l’État Patron trouvent que les salaires sont trop élevés. En échange de ces augmentations de salaire craintes mais attendues, il réorganisent la production et notamment augmentent l’intensité du capital investi (machines, encadrement, réorganisation de la chaîne productive). Autrement dit, le refus, même le plus borné et têtu, oblige les patrons les plus bêtes à être intelligents ou à sortir de la logique de la rente. Ce qui est vu par le patron individuel comme une perte est vu par le capital collectif comme une occasion de stimuler la productivité (à condition bien sûr que la production ne soit pas totalement bloquée). Quand on parle du rapport de classe précis, il ne faut pas figer le temps, le transformer en idéologie déconnectée de l’analyse concrète de conditions concrètes et tomber dans des déclamations intemporelles. La grande démission marque la réapparition de la lutte de classe sous sa forme du refus et prélude à des restructurations nouvelles dont le numérique dans ses déclinaisons récentes (celles de Chat GPT notamment) tente de remettre sur la défensive le mouvement social post-ouvrier.
Les analystes de gauche concentrent, pour la plupart, leur attention sur les mauvaises conditions de travail pour expliquer la pénurie de main-d’œuvre dans la plupart des secteurs d’emploi, incluant les services publics. Vous avancez, pour votre part, que le phénomène de la grande démission résulte d’une perte de sens du travail. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s’agit?
Les analystes (si l’on peut les appeler des analyseurs de l’état des rapports de force) qui soulignent que la détérioration des conditions de travail serait à l’origine de la pénurie de main-d’œuvre sous-entendent que les gens veulent bien travailler et qu’un capitalisme plus moral, plus soucieux des bonnes conditions de travail ne souffrirait pas de ces pénuries, bref que le salariat aime le travail, qu’il ne demande pas mieux que travailler. Ils se trompent lourdement. Travailler comme travailleur dépendant ne rend pas le travail digne et respectable en soi, c’est le dédommagement de la perte de l’autonomie, de l’indépendance. Et la force et l’intelligence spécifique du capitalisme par rapport au paternalisme des liens clientélaires, communautaires, consistent précisément à être capable de gérer et contrôler cette variable indépendante sans avoir besoin de recourir à l’asservissement. Et c’est tout sauf une sinécure, « un long fleuve tranquille » : la « direction des ressources humaines », ce n’est pas de la tarte ! Pas de misérabilisme ni d’angélisme des deux côtés. Les salariés, ouvriers, précaires ou pas, ne sont pas des miséreux, pas plus que les patrons rentiers. Les salaires élevés que se versent les cadres sont un dédommagement du stress permanent auquel les expose le salarié qui ose « débiner » de tous les côtés. Sauf une infime minorité qui a le privilège inouï de travailler pour son plaisir, notamment dans la création (et encore, voir les à côtés infernaux de la créativité), le travail directement dépendant (salarié, stable ou précaire) comme le travail prétendument « indépendant » (en fait subordonné aux règles du marché malgré son indépendance formelle vis-à-vis d’un employeur), a été et demeure de plus en plus inintéressant, répétitif et, disons-le brutalement, peu motivant.
Parmi d’autres formes de refus, vous parlez du « tang ping » apparu ces dernières années en Chine, pratique qui consiste à s’étendre sur le sol pour protester contre la culture du 996 (des journées de travail de 9 à 21 heures, six jours par semaine). Le phénomène fait beaucoup penser aux sit-in des infirmières québécoises contre la surcharge et le temps supplémentaire obligatoire, des grèves spontanées de quelques heures qu’on rencontre régulièrement dans les hôpitaux au cours de la dernière décennie. Y a-t-il des ponts à faire à l’international entre ces mouvements de refus?
Oui, bien sûr, mais il faut aller plus loin dans l’analyse : la ressemblance entre des formes de lutte ne crée pas nécessairement en soi une unification des mouvements de lutte. Une forme de lutte peut être particulièrement efficace et mettre les patrons et le capital sur la défensive ; mais la même forme de lutte dans un autre contexte peut être utilisée par le capital pour bloquer le mouvement. Autrement dit la même forme peut avoir un impact révolutionnaire, innovant, désarçonnant, mais se reprise ou sa « généralisation » peut un an, dix ans plus tard avoir un impact démobilisateur, émoussant. L’institutionnalisation du mouvement ouvrier ne cesse de le montrer. Par exemple la revendication par le mouvement ouvrier naissant de la dignité du travail, de son importance, de sa valeur qui a forgé les valeurs du mouvement socialiste et communiste naissant a été utilisé par le socialisme installé (la social démocratie ou le communisme soviétique) comme une idéologie répressive contre l’ouvrier très peu qualifiée que l’opéraïsme appelait l’ouvrier-masse. Plus récemment, la thématique de la lutte contre la désindustrialisation et la défense de l’emploi local à tout prix a pu et peuvent s’opposer aux luttes des sans-revenu, des chômeurs, des écologistes qui partent en guerre contre l’agrobusiness d’État.
CINQ PERTES DE SENS DU TRAVAIL
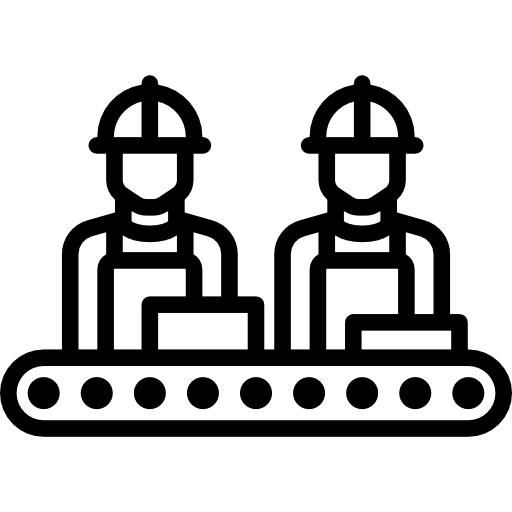
1. » La taylorisation ou l’industrialisation du secteur tertiaire : les emplois dans le secteur des services comme dans la fonction publique sont désormais organisés comme une chaîne de montage globale.

2. » L’intensification du contrôle par la numérisation : la figure du contremaître sur le corps de l’ouvrier disparaît au profit d’un environnement « intelligent » qui espionne de façon bien plus efficace. L’industriel comme le primaire se sont tertiarisés: la moitié du travail d’un agriculteur exploitant se passe derrière un ordinateur à faire de la gestion. Et l’angoisse du découvert bancaire a remplacé la hantise d’une hausse du prix du pain.

3. » Le passage à un capitalisme exploitant de plus en plus la force d’invention et pas simplement la force de travail : il est demandé désormais au travail dépendant ou subordonné (explicitement salarié, formellement indépendant – ubérisé – ou réellement indépendant) de s’engager subjectivement dans sa tâche et de faire preuve d’autonomie, d’initiative, y compris dans des tâches prescrites, ce qui est contradictoire aux deux phénomènes précédents.

4. » L’objection écologique : elle remet en cause tout le récit et l’épopée prométhéenne du travail moderne. Si l’étalon de mesure n’est plus celui de la croissance matérielle des biens inertes, mais celui de la reproduction du vivant – ses conditions de survie à la surface de la planète –, l’ensemble de cette extraordinaire et monstrueuse théodicée du travail s’effondre.
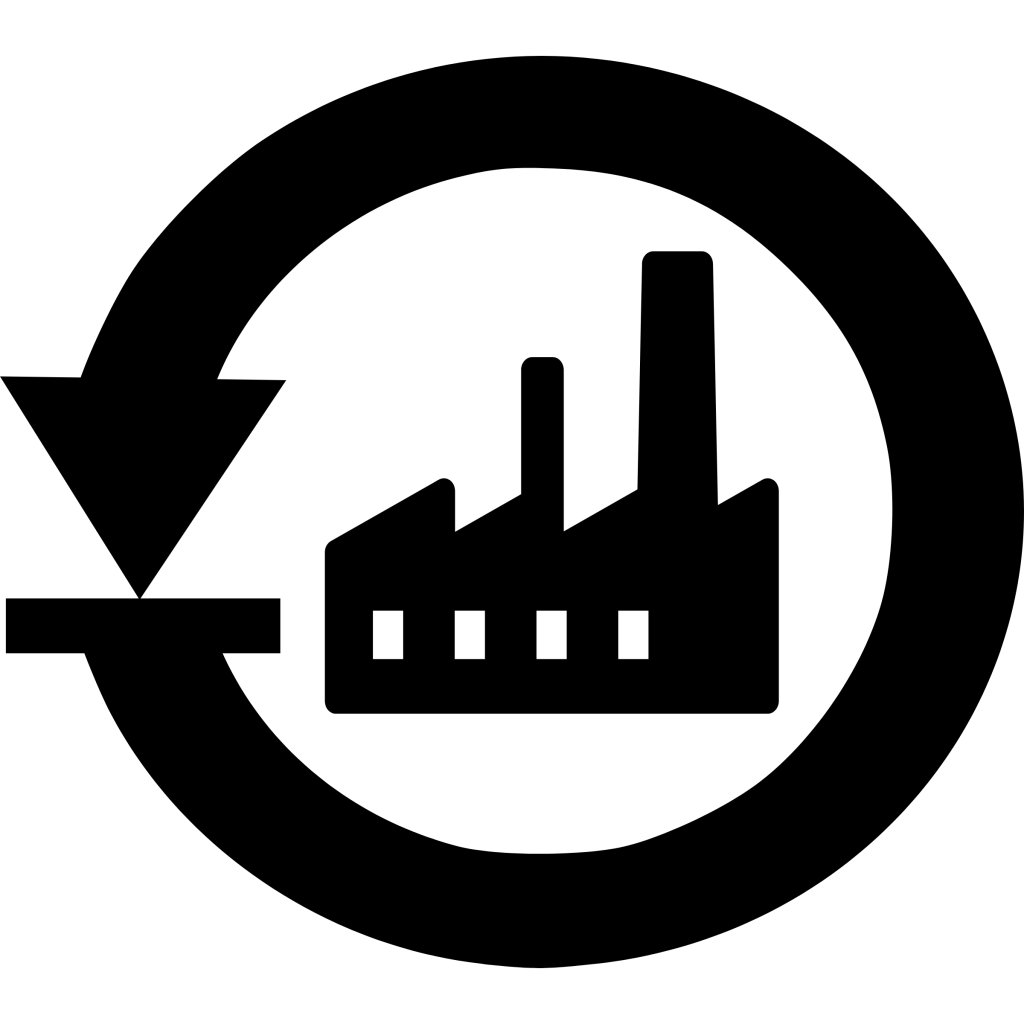
5. » Les assurances maladies d’abord organisées par les syndicats, les assurances retraites, la prise en compte des familles, la protection sociale ont éloigné de plus en plus le Welfare State ou État-Providence d’un simple workfare, c’est-à-dire, des mesures minimales permettant d’assurer l’approvisionnement en travailleurs des usines et des bureaux. Le coût du travail est devenu le coût de l’activité en société en général, dans l’équivalent du passage de la sur-valeur absolue et simple en sur-valeur relative et complexe comprenant les frais de reproduction de la société.
*Tiré de « La lune de la grande démission, le doigt de la valeur-travail », Multitudes no. 90, printemps 2023.
Notes
1. Yann Moulier Boutang, « La lune de la grande démission, le doigt de la valeur-travail », Multitudes no. 90, printemps 2023. ⤴
2. Mario Tronti, Ouvriers et capital, Genève : Entremonde, 2016. ⤴
3. Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat : économie historique du salariat bridé, Paris : PUF, 1988. ⤴